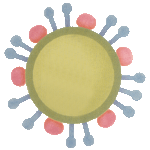|

|
ASCARIDIOSE
|
 |
 |
|
|
|
Plan de la page
Définition
Agent pathogène
Cycle parasitaire
Répartition géographique
Clinique
Traitement
Prophylaxie
|
Définition |

Imprimer
cette page
|
|
C’est une parasitose
intestinale, cosmopolite, très courante, due à la présence dans l’organisme
d’un nématode spécifique de l’homme, l’ascaris, provoquant
des troubles intestinaux souvent importants et parfois graves.
|
|
Agent
pathogène |
|
C’est un Métazoaire, de l’embranchement
des Némathelminthes, de la classe des Nématodes, de l’espèce Ascaris
lumbricoides. C’est un vers rond, blanc rosé, mesurant 15 à
20 cm.
|
|
Cycle
parasitaire |
|
Les ascaris vivent dans l’intestin
grêle de l’homme contaminé pendant 12 à 18 mois. Les femelles
fécondées y pondent des milliers d’œufs éliminés avec les
selles dans le milieu extérieur où ils peuvent persister pendant
plusieurs années.
La contamination humaine résulte de l’ingestion de crudités, d’eau
ou de terre souillée contenant des œufs embryonnés.
Les larves libérées perforent la paroi intestinale et gagnent le
foie, le cœur droit, les poumons, remontent l’arbre respiratoire
et sont dégluties dans l’œsophage. Les larves se transforment en
adulte dans le grêle puis émettent, à leur tour, des œufs.
|
|
Répartition géographique |
|
C’est une parasitose cosmopolite mais
qui touche principalement les pays en développement à faible
niveau d’hygiène hydrique et fécale.
Dans les pays tropicaux, les hyper infestations sont fréquentes car
la maturation des œufs dans le milieu extérieur dépend d’une
température élevée et, de plus, le risque de péril fécal y est
élevé.
En France et dans les pays tempérés, l’ascaridiose est
occasionnelle et les infestations pauci-parasitaires.
|
|
Clinique
|
|
En cas de charge parasitaire
faible, les symptômes sont absents.
Dans le cas contraire, on observe :
 |
une
phase de migration larvaire qui correspond au passage
des larves à travers le poumon et qui se manifeste par
le syndrome de Loeffler : toux d’irritation peu
productive, dyspnée, fièvre autour de 38°C… |
 |
une
phase d’état, correspondant à la présence des vers
adultes dans l’intestin grêle, qui provoquent des
troubles digestifs non spécifiques et qui sont
néfastes soit : |
-par une action spoliatrice et irritative avec des troubles du
transit (diarrhées), douleurs abdominales, nausées,
vomissements ;
-par une action toxique avec des signes cutanées (urticaire),
respiratoires (toux, dysphonie ), articulaires (arthralgies ) et
neurologiques (crises convulsives, réactions méningées, confusion
mentale ) ;
-par une action mécanique, liée au vers lui-même et au nombre de
parasites, avec une migration dans les muqueuses et les divers
canaux.
 |
l’évolution |
Les complications chirurgicales,
largement décrites, sont exceptionnelles dans les pays développés
où l’intensité du parasitisme est faible. L’engagement d’un
ascaris dans un canal (voies biliaires et pancréatiques), une
occlusion intestinale, un étranglement herniaire, une perforation
intestinale ou une rupture des sutures chirurgicales en post
opératoire sont, malgré tout, possibles. |
|
Définition
Agent pathogène
Cycle parasitaire
Répartition géographique
Clinique
|
Traitement |
|
L’efficacité de la plupart des antihélminthiques, y
compris l’ivermectine, est remarquable.
En première intention, on utilisera :
-le
flubendazole FLUVERMAL®, contre-indiqué chez la femme
enceinte ;
En deuxième intention, seront donnés :
-le
pamoate de pyrantel COMBANTRIN®, en prise unique ;
-l’albendazole
ZENTEL®, disponible seulement à la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux ;
-le
levamisole SOLASKIL®, en prise unique.
|
|
|
Prophylaxie |
|
La prophylaxie individuelle et collective
repose donc sur l’hygiène générale :
-par la lutte contre le péril fécal : la
propreté des mains et la surveillance de son alimentation sont
fondamentales (voir Hygiène Alimentaire) ;
-par la surveillance des enfants, à l’âge
où ils mettent tout à la bouche (géophagie).
|
| |


Poser vos questions
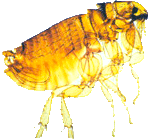
La parasitologie et la Mycologie
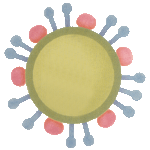
Les maladies tropicales

Le conseil

Votre Avis...

Quitter le site
|